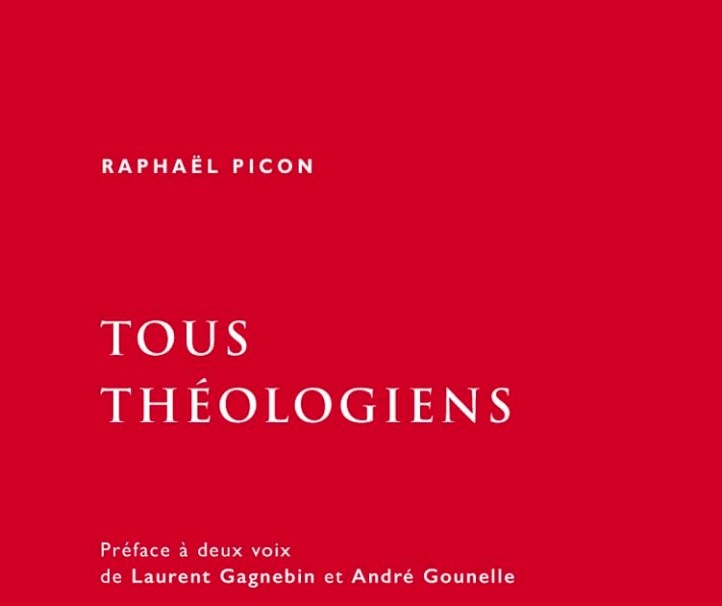
Disclaimer : ce billet n’est pas un retour de lecture rigoureux, mais plutôt certaines réflexions qu’on suscitées ce livre après lecture.
————————————————————————————-
Sur la page de présentation de ce blog, je dis ceci : « je défends le ministère laïc d’une part et l’idée que la théologie et la spiritualité sont l’affaire de tous, qu’elles peuvent être populaires et non seulement l’apanage de spécialistes. » Fatalement, cette posture infuse certaines de mes discussions, et c’est naturellement qu’un ami théologien, suite à nos discussions, m’a transmis le livre de Raphaël Picon, « Tous théologiens ».
Cet ouvrage part d’une intention louable. Il tente d’ouvrir la théologie à tous, rendre chaque croyant acteur du discours théologique, et ainsi favoriser un retour à l’idée du sacerdoce universel. Le préfacier met en avant plusieurs arguments pour justifier cette démocratisation : une meilleure transmission de l’Évangile, une réponse à la crise de la théologie et de l’Église, et une volonté de supprimer la dissonance entre l’enseignement du sacerdoce universel et sa mise en pratique. Pourtant, cette démarche pose un problème fondamental : en voulant donner la parole à tous, ne cherche-t-on pas, en réalité, à encadrer et à normaliser une parole qui n’avait pas besoin (ni nécessairement vocation d’ailleurs) d’être institutionnalisée ? Picon propose une vision ambitieuse et ouverte de la théologie : chacun, croyant ou non, serait théologien, apportant ainsi sa pierre à l’édifice théologique. Et mon ami de me dire qu’effectivement, la théologie populaire pourrait venir vivifier la théologie académique. J’étais au premier abord intéressé, ayant tenté pendant un temps de développer un intérêt pour la théologie, sans pour autant avoir suivi un cursus universitaire. Une démarche en apparence libératrice, qui cherche à sortir la théologie des cercles académiques pour la rendre accessible à tous. Pourtant, même si je crois l’auteur bien intentionné, cette vision soulève pour moi un paradoxe profond : en proclamant « vous êtes tous théologiens », ne force-t-on pas chaque croyant à entrer dans le cadre même, trop restrictif, de la théologie ? Sans compter que l’on peut se poser la question de la légitimité et de l’intérêt des arguments mis en avant par le préfacier du livre.
Dire Dieu ou faire de la théologie ?
D’abord, il faut bien le dire : la théologie occupe une place prépondérante dans l’institution ecclésiale, au point que l’on peine parfois à différencier les choses. La théologie n’est pas la foi. Elle n’est pas non plus l’Eglise. Etre pasteur et être théologien sont deux choses différentes et l’on peut être les deux en même temps. Etre chrétien et être théologien aussi. Et finalement, parler de l’idée Dieu, et donc de soi par le prisme d’une perception subjective du monde par l’interprétation de l’existence d’un divin, ce n’est pas en soi « faire de la théologie ». Il faut donc, disais-je différencier les choses. Lorsqu’une personne parle de Dieu, est-elle en train de faire de la théologie ? Ou bien est-elle simplement en train de se dire, d’exprimer son expérience intime du divin et de son rapport au réel ? La distinction est essentielle, car si parler de Dieu est une forme d’expression existentielle, alors qualifier cette parole de « théologie populaire » revient à lui imposer un cadre qui n’était pas nécessaire. En créant le statut de théologien populaire depuis « le haut », on transforme une parole spontanée et individuelle, singulière, en un objet de savoir normalisé et collectivement structuré. Ce qui était une simple expression du soi devient une catégorie qui peut être analysée, débattue, récupérée dans le cadre théologique. Or, les personnes qui parlent de Dieu, qui partagent leur expérience, ne cherchent pas nécessairement à faire avancer la théologie ou à enrichir un corpus de savoirs. Et l’expérience intime n’a pas a être débattue, analysée et récupérée. Les personnes cherchent avant tout à dire leur expérience du monde et du divin. Elles cherchent à se dire. Il convient donc ici de différencier aussi deux choses : La théologie et la phénoménologie.
Ce qui semble être une démocratisation de la théologie, je le perçois en fait comme une forme subtile d’institutionnalisation de l’intime. Je pose l’hypothèse qu’il s’agit d’une réification de l’expérience personnelle. En affirmant que chaque croyant est un théologien populaire, tout en étant soi-même théologien, on contraint implicitement le croyant à penser Dieu à travers les outils de la théologie (dont le théologien a la maîtrise en amont). Il ne peut plus simplement vivre sa foi, il finit par la conceptualiser, l’argumenter et la structurer dans un langage déjà codifié. On fusionne alors deux choses qui sont à la base différenciées : l’expression de foi et la théologie. Or l’expérience ne s’argumente pas, elle se partage tout au plus. La pensée spontanée du divin se retrouve captée et récupérée dans un champ disciplinaire préexistant. Il faut néanmoins reconnaître que l’intention de Picon n’est pas de figer la réflexion, mais au contraire de décloisonner la théologie. Son approche s’inscrit dans la logique du sacerdoce universel, où chaque croyant peut être acteur de sa propre spiritualité et contribuer au discours théologique. En ouvrant l’accès à la réflexion sur Dieu à tous, il espère enrichir la théologie par l’expérience vécue et le phénomène religieux lui-même. La préface du livre met en avant plusieurs arguments en faveur de ce concept :
- Une meilleure communication de l’Évangile, en démultipliant les témoins et en rendant la transmission plus efficace.
- Une réponse à la crise de la théologie et de l’Église, puisque la théophanie ne serait plus seulement l’affaire des théologiens, mais des individus eux-mêmes.
- Un retour à la cohérence avec le sacerdoce universel, supprimant une dissonance entre théorie et pratique.
- Une valorisation du débat et de l’échange, en intégrant davantage de voix dans la réflexion théologique.
Cependant, à aucun moment il n’est question de redonner la parole aux croyants simplement parce qu’ils sont légitimes à la prendre. Le regard porté sur eux semble davantage utilitariste : ils sont perçus comme des outils pour revitaliser la théologie et l’Église, plutôt que comme des sujets en tant que tels. La parole doit leur être donnée, car ils sont légitimes à la prendre en soi, et non en raison d’un éventuel bénéfice qu’on pourrait en tirer. Laisser les personnes dire Dieu et se dire ne devrait pas être une stratégie pour améliorer l’Église ou la théologie ; cela devrait être un droit fondamental, basé sur leur légitimité intrinsèque à exister et à appartenir au groupe, au même titre (et au même niveau) que les théologiens eux-mêmes. Au regard de la foi, et face à Dieu, les théologiens et la caste sacerdotale sont des croyants comme les autres.
Une autre question se pose : cette ouverture profite-t-elle vraiment aux croyants ? Ou bien est-ce la théologie elle-même qui s’en trouve enrichie ? Ou l’institution ecclésiale ? Ou, selon le contexte, les velléités de pouvoir de certains individus ? La manière dont Tous théologiens présente la théologie populaire laisse entendre que cette intégration est bénéfique pour la théologie. En donnant la parole aux croyants, on revitalise le discours théologique, on nourrit l’institution ecclésiale, on crée un débat dynamique. Autrement dit, les croyants sont valorisés non pas pour eux-mêmes, mais pour ce qu’ils apportent à la théologie et à l’institution.
Un parallèle avec les béguines
Les béguines, ces femmes chrétiennes du Moyen Âge, ne rentraient ni dans la structure monastique ni dans la vie laïque classique. Elles développaient une spiritualité libre, fondée sur l’expérience personnelle du divin, sans passer par l’autorité sacerdotale. Elles refusaient d’être cloisonnées dans un statut imposé par l’Église. L’Église a toléré les béguines à certaines époques, mais avec méfiance. Elles étaient utiles par leur engagement spirituel et social, mais leur indépendance dérangeait. Certaines ont même été persécutées (comme Marguerite Porete, brûlée pour hérésie). De la même manière, la théologie populaire, telle que pensée par Picon, est reconnue et valorisée, mais dans des limites fixées par la théologie académique.
Les béguines ne demandaient pas l’autorisation de l’Église pour parler de Dieu, elles le faisaient naturellement, dans un cadre qui leur était propre. Leur existence même remettait en cause l’idée que seuls les clercs pouvaient structurer le discours sur le divin. L’Église n’a jamais pleinement intégré les béguines dans son organisation : elle leur a laissé une place marginale, tout en veillant à ce qu’elles ne sortent pas du cadre acceptable. De même, en reconnaissant les croyants comme théologiens populaires, l’institution leur donne une place, mais dans un cadre qu’elle définit elle-même. C’est une inclusion qui n’est pas une liberté, puisqu’elle est indirectement contrôlée.
Les béguines n’ont pas attendu une reconnaissance officielle pour exister : elles ont vécu leur spiritualité selon leurs propres termes. De la même manière, si les croyants veulent vraiment être libres dans leur parole sur Dieu, ils ne doivent pas attendre que les théologiens leur donnent cette place, ou que les clercs lâchent leur autorité. Ils doivent s’exprimer en dehors du cadre de la théologie institutionnelle, comme les béguines l’ont fait en leur temps.
Si la théologie académique est un discours sur Dieu, alors elle fonctionne par concepts, par cadres de pensée, par catégories. Elle analyse, ordonne, structure. Mais qu’en est-il de ceux qui vivent Dieu sans passer par ce langage codifié ? L’expérience mystique, et en particulier celle des femmes mystiques du Moyen Âge, montre une autre voie : une spiritualité qui ne se dit pas seulement en mots, mais qui se vit dans le corps. Les béguines, comme d’autres figures mystiques, n’ont pas attendu d’être reconnues par l’Église pour parler de leur relation au divin. Elles ne faisaient pas « de la théologie » au sens académique, mais elles témoignaient d’une rencontre avec Dieu, une rencontre vécue, souvent extatique, parfois même à la limite du supportable. Leurs expériences étaient corporelles : visions, souffrances, élans d’amour mystique, sensations physiques de brûlure ou d’extase… Tout cela dépassait le cadre rationnel dans lequel une institution voudrait enfermer la parole sur Dieu. C’est ce qui rendait ces expériences subversives : le corps (l’expérience, le phénomène) fait éclater le cadre. Là où l’institution cherche à organiser le discours théologique, le corps impose une parole qui ne peut être récupérée, qui échappe aux catégories. Pire, le corps et l’expérience vécu plus que de vivifier la théologie viennent en général plutôt l’éprouver. Car l’expérience corporelle indicible se dérobe au dicible des théologiens. Et c’est peut-être là la vraie théologie populaire : non pas une théologie validée et institutionnalisée sous un nouveau label, mais une parole brute, incarnée, irréductible au discours académique.
Eckhart, en s’intéressant à ces femmes mystiques, a reconnu cette puissance. Il a compris que la théologie ne se limitait pas à ce qui pouvait être conceptualisé, mais qu’elle se trouvait aussi dans l’expérience immédiate, dans la vie vécue. Pourtant, aujourd’hui encore, la tendance est de vouloir inscrire ces voix dans un cadre préétabli : on parle de « théologie populaire » pour donner une place aux croyants, mais une place qui reste définie par les théologiens eux-mêmes. Comme si la parole du croyant devait être validée pour exister, au lieu d’être simplement reçue comme une expression légitime de la foi. Alors peut-être faut-il refuser ce piège. Peut-être faut-il reconnaître que les croyants qui parlent de Dieu ne font pas forcément de la théologie : ils existent, ils témoignent, ils vivent. Et c’est précisément dans cette liberté que réside leur force. Comme les mystiques, ils n’ont pas besoin d’un cadre pour parler de Dieu. Leur parole se suffit à elle-même, car elle est portée par l’expérience du corps, du phénomène, de l’épaisseur du réel. Et cette expérience ne vient en fait pas en soi vivifier la théologie, mais elle vient d’abord l’éprouver. La phénoménologie agit en réalité comme révélateur des limites du discours théologique.
La Boétie et le discours de la servitude volontaire
Face à cette captation, ma réponse consiste alors finalement à refuser de me définir comme théologien. Je vais personnellement même jusqu’à refuser de me définir comme chrétien, tant ce mot est jalonné de présupposés. On peut réfléchir au divin, à l’expérience spirituelle, sans entrer dans le cadre disciplinaire de la théologie. Plutôt que de suivre une méthode académique, je pars du phénomène lui-même, de l’expérience vécue, car je m’ancre dans la corporalité plus que dans l’analyse de concepts pour penser le divin (quelque soit ce que j’entends par là) sans le faire entrer à tout prix dans une grille préexistante. Cette approche permet de s’affranchir du piège de l’encadrement doctrinal. Plutôt que d’accepter d’être inclus dans une théologie soi-disant ouverte, elle me propose de penser autrement, en réinterrogeant les catégories même du discours sur Dieu. Peut-être que la véritable liberté de pensée sur le divin ne réside pas dans une théologie élargie, mais dans une réflexion affranchie de la théologie elle-même.
Dans son Discours sur la servitude volontaire, La Boétie montre que l’oppression ne disparaît pas simplement en dénonçant les tyrans. Elle prend fin lorsque les opprimés cessent d’accepter leur condition et reprennent leur autonomie. « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres » nous dit-il. Ici, même si nous ne sommes pas dans une situation d’oppression à proprement parler (je ne compare pas les théologiens à des tyrans, entendons-nous), on retrouve un mécanisme similaire : Tant que les croyants acceptent d’être contenus dans un cadre théologique donné, ils restent enfermés dans un cadre défini par d’autres. Tant qu’ils cherchent à être reconnus par la théologie/les théologiens (comme ce fut longtemps mon cas), ils en légitiment implicitement les structures. La véritable émancipation ne vient pas d’une reconnaissance académique, mais du fait que les croyants cessent d’attendre cette reconnaissance et prennent la parole indépendamment du cadre imposé.
À première vue, la théologie populaire semble être une avancée vers un accès plus large au discours sur Dieu. Elle permet aux croyants de s’exprimer, de témoigner, d’interpréter leur foi sans être cantonnés à un statut de simples pratiquants. Toutefois, Picon est avant tout un théologien. Cette ouverture est donc initiée et encadrée par ceux qui possèdent déjà le pouvoir de dire ce qu’est la théologie : les théologiens eux-mêmes. Le problème n’est pas que la théologie se démocratise, mais que cette démocratisation soit décidée et structurée par ceux qui dominent déjà le champ théologique. C’est ce qui se joue dans l’expression du sacerdoce universel lui-même : la doctrine est élaborée et mise en pratique d’abord par ceux qui l’ont développé, mais non pas par ceux qui devraient en être les « bénéficiaires ». Les croyants ne prennent pas la parole par eux-mêmes et pour eux-mêmes : on leur donne la parole dans un cadre qui reste celui de la théologie. Ce n’est pas une remise en cause du pouvoir des théologiens dans l’institution ecclésiale et leur autorité accordée dans la foi des croyants, c’est une intégration des non-théologiens dans un espace où les règles du jeu ont déjà été écrites.
La vraie question : pourquoi faudrait-il faire de tous les croyants des théologiens ?
Au lieu d’accepter d’être intégrés dans un cadre préexistant, pourquoi ne pas renverser totalement la perspective ? Pourquoi faudrait-il nécessairement être un théologien – même populaire – si l’on propose un discours sur Dieu ? Cette réflexion m’amène à ma propre posture : je ne suis pas théologien. Et je ne le serai jamais, tout simplement parce que je n’ai pas fait et ne ferai pas d’études en théologie. Un théologien est une personne qui a un diplôme de théologie. Je suis une personne qui s’est intéressé à la théologie, qui en lu beaucoup, qui s’est initié à la pratique de la théologie et de l’exégèse, mais je ne suis pas un théologien. Je parle du divin, je critique l’institution ecclésiale, sans chercher à être validé par un cadre académique. Je ne cherche pas à être inclus dans la théologie ; je me positionne en dehors, sans ressentir le besoin d’être labellisé comme légitime par elle. La vraie liberté ne réside donc pas dans une ouverture de la théologie, mais dans une prise de parole qui ne demande pas à être reconnue par elle. Ce n’est pas aux théologiens de décider qui peut parler du divin ni comment le faire, même si l’intention est louable. C’est aux croyants de le faire sans attendre qu’on leur en donne l’autorisation. Si la théologie est un objet d’étude qui m’intéresse, et que je sais en utiliser certains outils, je ne suis pourtant pas et ne serai donc jamais un théologien.
Si l’on veut vraiment redonner une parole aux croyants, alors il faut aller plus loin que l’ouverture du champ théologique : il faut accepter que leur parole ne soit pas forcément encadrée par l’institution ecclésiale ou théologique. Et la théologie doit accepter d’être mise à l’épreuve par l’expérience et la phénoménologie. La mystique, la poétique, le philosophique, l’existentiel, sans pour autant avoir besoin d’être théorisée et analysée dans un cadre préexistant ont voix au chapitre. Il est essentiel de réaffirmer que les croyants ont une parole légitime en tant que sujets et non en tant qu’objets d’une démarche théologique plus vaste. Leur voix ne doit pas être captée et structurée sous un prétexte d’ouverture. La vraie démocratisation du discours religieux n’est pas d’intégrer les croyants dans la théologie, mais de les laisser s’exprimer sans chercher à définir leur parole par des critères académiques ou institutionnels.
La dérive ou le fanatisme comme alibis
C’est une critique classique : sans cadre théologique structurant, ne risque-t-on pas de tomber dans le chaos des interprétations individuelles, voire dans le fanatisme ? Cette crainte est souvent formulée par les théologiens académiques, qui voient dans leur discipline un rempart contre les excès. Parfois même par certains croyants qui pensent que la théologie est le geste qui leur permettrait de ne pas dériver. Pourtant, cette objection repose sur une confusion entre absence de contrôle institutionnel et absence de discernement. L’histoire montre que les mouvements spirituels non encadrés ne sombrent pas nécessairement dans l’extrémisme. Les béguines, les mystiques médiévales ou les communautés chrétiennes spontanées n’ont pas toutes viré au fanatisme. Au contraire, c’est souvent l’institution qui a jugé leurs expériences trop dérangeantes et les a qualifiées de suspectes.
L’argument selon lequel la théologie protège du fanatisme est fragile : les plus grandes dérives historiques ont souvent été justifiées par des théologies structurées. L’Inquisition, les guerres de religion, le colonialisme missionnaire ou les justifications théologiques de l’esclavage sont des dérives qui ne sont pas issues d’une théologie populaire incontrôlée, mais bien de discours académiques et institutionnels. Plus récemment, les thérapies de conversions sont le fait d’une force institutionnalisée. À l’inverse, des figures indépendantes, comme certaines mystiques ou réformateurs radicaux, à l’instar de Luther, ont souvent été les premières à dénoncer des abus. Contrairement à une idée reçue, l’expérience directe du divin et l’interprétation que l’on en fait, n’est pas nécessairement un terrain propice au fanatisme. Au contraire, le fait de partir du corps, du phénomène, de l’expérience concrète empêche les idéologies abstraites de prendre le pas sur le réel. Le fanatisme ou la dérive naît souvent d’une volonté de séparer la foi de la réalité vécue, d’imposer un dogme rigide plutôt que de reconnaître la complexité du vécu humain. Une approche incarnée, fondée sur l’expérience personnelle et communautaire, tend au contraire à être plus humble, plus ouverte à l’altérité.
Refuser l’encadrement rigide de la théologie académique ne veut pas non plus dire sombrer dans un individualisme absolu où chacun inventerait sa propre religion déconnectée des autres. Au contraire, les expériences spirituelles se construisent toujours en dialogue avec une communauté. Mais cette communauté peut être fluide, organique, horizontale, sans nécessairement être soumise à une autorité doctrinale centralisée. Plutôt que de craindre l’absence de contrôle théologique, il faut reconnaître que ce ne sont pas les institutions qui garantissent la justesse d’une parole spirituelle, mais la manière dont elle est incarnée dans le vécu. Loin d’ouvrir la porte au fanatisme, l’affranchissement des cadres académiques peut permettre une parole plus libre, plus enracinée dans l’expérience humaine, et donc, paradoxalement, moins sujette aux dérives dogmatiques que les théologies qui cherchent à imposer une seule vision du monde.
Ce qui prémunit véritablement des dérives, ce n’est pas tant la présence d’un cadre théologique rigide que la mise en dialogue des subjectivités. L’expérience spirituelle, pour ne pas devenir monologue narcissique ou dérive autoritaire, a besoin d’être confrontée, discutée, mise en tension avec d’autres récits. Le philosophe Marc-Alain Ouaknin répond souvent à ceux qui lui demandent son interprétation d’un texte : « D’accord, je te donne la mienne, à condition que tu m’en donnes une différente. » C’est ce croisement des regards, cette intersubjectivité, qui crée un espace de vigilance mutuelle, d’ouverture, de nuance. Là où l’institution prétend garantir la vérité en la figeant, le collectif vivant — fluide, dialogique, parfois conflictuel — permet une recherche commune sans clôture dogmatique. C’est dans cet échange que se joue la justesse d’une parole spirituelle : non dans son autorité, mais dans sa capacité à résonner, à se laisser interroger, à se transformer au contact des autres.
Conclusion
L’idée d’un sacerdoce universel, où chaque croyant est théologien, semble séduisante. Mais lorsqu’elle est théorisée par ceux qui ont historiquement le monopole de la théologie (et donc du champs discursif), elle risque de n’être qu’un moyen de redéfinir la discipline sans vraiment renoncer à son contrôle. La vraie libération n’advient pas quand une caste dominante décide d’inclure de nouveaux acteurs, mais quand ces derniers se définissent eux-mêmes sans chercher la reconnaissance de ceux qui les encadraient jusque-là. Ce n’est pas en intégrant les croyants dans la théologie qu’ils deviennent libres. C’est en cessant d’attendre cette intégration et en prenant la parole pour eux-mêmes, hors du cadre imposé.
Pour ma part, j’ai longtemps cherché une légitimité institutionnelle à travers mon attrait pour la théologie. J’ai même tenté de suivre des formations, pensant qu’un vernis académique pourrait donner à ma parole une forme de caution. Comme si, pour être entendu, je devais m’extraire de ma condition de « simple croyant » et m’élever vers une forme reconnue de savoir. Car il faut le dire : dans l’Église, la parole du théologien ou du pasteur est encore bien souvent érigée comme supérieure — parfois même placée au-dessus de celle des laïcs, quand bien même ces derniers auraient une parole profondément éclairée, nourrie par l’expérience, par l’écoute, par la vie.
Mais un jour, j’ai compris que je n’avais pas à demander cette reconnaissance. Que ma parole était déjà légitime, non parce qu’elle serait validée par un diplôme ou une fonction, mais parce qu’elle s’enracinait dans un chemin spirituel singulier. Je n’avais pas besoin d’un label théologique qui me donnerait de la valeur. Ce renversement intérieur m’a libéré. Il ne s’agissait plus de rejoindre une caste, mais d’habiter pleinement ma place, de parler depuis là où je suis, avec les mots qui me sont donnés. Il faut donc laisser la théologie aux théologiens et à ceux que cela passionne. Pour le reste, parlons simplement de parole vivante (j’utilise le terme de « parole vivante » dans une signification non religieuse) qui voyage entre les personnes.
Sur la page de présentation de ce blog, je dis ceci : « je défends le ministère laïc d’une part et l’idée que la théologie et la spiritualité sont l’affaire de tous, qu’elles peuvent être populaires et non seulement l’apanage de spécialistes. » Ainsi, pour être cohérent avec la critique que je formule ici, je devrais plutôt affirmer que la parole spirituelle n’a pas besoin d’être appelée “théologie” pour être légitime, et que nul n’a à devenir théologien, même populaire, ni même à entrer dans le champs discursif de la théologie pour investir l’idée de Dieu et pour dire son expérience. Surtout, nul ne devrait avoir à faire tout cela pour être légitime… parole de laïc non théologien.
Postlude – Pour un inconfort partagé
Après l’avoir rédigé et avant de le publier, j’ai envoyé ce texte à Elio, qui m’avait transmis le livre de Picon. Je sais que certaines lignes de mon texte sont abruptes, parfois tranchantes. Mon ami me l’a fait remarquer avec justesse : en forçant la critique, je risque de dresser un tableau trop binaire, d’opposer la parole vive à la théologie comme si elles étaient inconciliables. Peut-être. Mais je ne cherche pas à contourner la rigueur ni à fuir l’exactitude : je cherche à la déplacer, à la désinstitutionnaliser. Ce texte est traversé par une sensibilité libertaire, une méfiance constitutive envers les formes d’autorité, les titres, les cadres normatifs fussent-ils bien intentionnés. Ce que je conteste, ce n’est pas l’idée de penser Dieu par le prisme du champs théologique, mais l’idée de vouloir ramener les individualités singulières dans ce champ, dans un langage déjà balisé, au sein d’un espace délimité d’en haut. Il ne s’agit pas de nier que toute parole s’inscrit dans une culture et une langue ; je le sais, et je ne parle pas depuis un lieu vide. Mais justement : reconnaître cela, c’est aussi pouvoir dire que certains langages sont structurés pour absorber, homogénéiser, parfois même neutraliser la parole spontanée de celles et ceux qui vivent Dieu autrement.
Elio me rappelle aussi que la proposition « tous théologiens » peut être reçue comme un geste hospitalier, un appel à élargir la table du dialogue. Je n’ignore pas cette portée, et je l’accueille. Mais je persiste à croire que ce geste reste ambivalent, tant qu’il ne s’accompagne pas d’un véritable dessaisissement. Car tant qu’on nomme “théologie populaire” ce qui émerge des marges, c’est encore depuis le centre qu’on distribue les titres. Et alors même que l’intention est de démocratiser, le risque demeure : celui de capter ce qui précisément échappe.
Ce que je propose n’est pas une extériorité pure, ni un refus de la théologie par principe. C’est une insistance. Une insistance sur ce qui déborde, ce qui résiste à la formalisation, ce qui se dit sans chercher à s’inscrire dans un corpus. Une parole qui ne veut pas conquérir le champ, mais exister à côté, en contrepoint, à sa manière. Il ne s’agit pas de désavouer celles et ceux qui travaillent dans le champ théologique, mais de dire que l’on peut aussi vivre ailleurs. Et que cet ailleurs n’a pas besoin d’être validé pour être légitime. Alors peut-être que ce texte n’est pas une réponse fermée, mais une provocation fraternelle. Un appel à ce que le dialogue entre les savoirs, les expériences, les langues de la foi, reste un lieu d’inconfort partagé. Là où personne ne tient le centre trop longtemps, où personne ne distribue les rôles à l’autre sans être à son tour déplacé.
Pour lire les billets d’Elio à ce sujet :