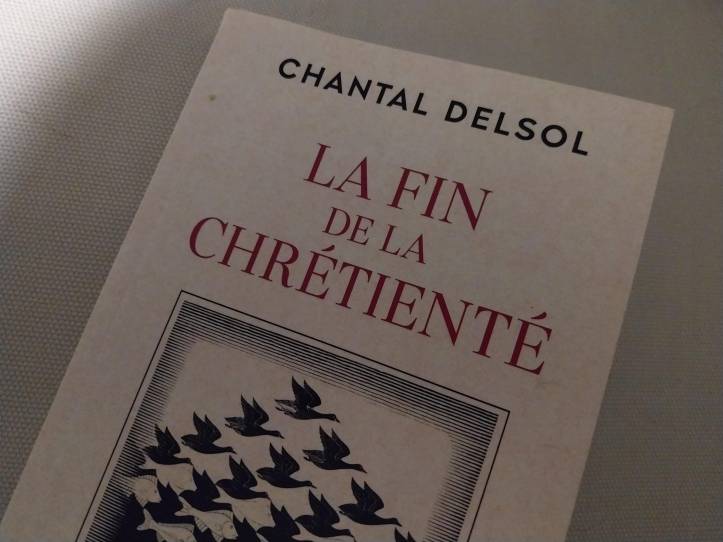
Avant de lire ce billet, je précise que l’autrice écrit dans un contexte différent du mien. Il est question d’un ancrage français. Ainsi, lorsqu’il est question d’Église par exemple, l’autrice parle probablement de l’Église catholique spécifiquement, étant en plus elle-même ouvertement catholique traditionaliste. De plus, les questions de politique, de gouvernance, de médias, de laïcité sont propres à contexte français, bien différent du modèle suisse dans lequel j’évolue. C’est donc dans ce contexte qu’il faut comprendre le propos de l’autrice. Ce qui n’empêche bien entendu pas de faire des parallèles et de reprendre certaines notions à recontextualiser.
———————————————————————–
C’est en flânant à la librairie que j’ai trouvé ce livre. Une ambivalence naît lorsque je lis le 4ᵉ de couverture, qui ne fut pas pour me déplaire. Même si j’aime à lire des livres qui vont dans le sens contraire de ce que je pense pour éprouver ma pensée, a priori, je n’étais pas destinée à lire un livre de Chantal Delsol tant elle est aux antipodes de ce qui me nourrit habituellement : catholique, traditionaliste, semble quelque peu monarchiste selon un ami l’ayant déjà entendu, chroniqueuse au Figaro, etc. Mais la lecture du 4ᵉ de couverture m’a interpelé : « L’ère chrétienne qui s’achève avait vécu sur le mode de la domination. Le christianisme doit inventer un autre mode d’existence. Celui du simple témoin. De l’agent secret de Dieu. » Une catholique traditionaliste qui ne va pas m’expliquer que c’était mieux avant, ni que tout le monde devrait revenir à la tradition catholique. Voilà qui m’intéresse.
Une distinction salvatrice
D’emblée, je me plonge dans la lecture, car je comprends que j’ai affaire à une personne intelligente, nuancée et mesurée. Tout d’abord, dans sa distinction lexicale. En effet, l’autrice ne tombe pas dans le piège de l’amalgame du sens des mots. La foi, l’expression de foi, l’Église, le christianisme (au sens de la religion) et la chrétienté sont autant de concepts que l’on sent certes liés les uns aux autres, mais qui sont explicitement dissociés. Ainsi, je sais que je commence à lire le livre d’une personne qui ne confond pas sa foi avec l’Église, le christianisme avec la chrétienté. Cette confusion, rencontrée quotidiennement dans mon travail, fait qu’il est extrêmement difficile d’avoir une discussion construite et surtout calme avec certains croyants. Dès la première page de son récit, elle dit : « L’Église est éternelle pour les catholiques : il y aura toujours un groupe de fidèles, si maigre soit-il, pour la constituer. Mais la Chrétienté, c’est bien autre chose. (p.9) » Cette phrase anodine en apparence, me laisse entendre, en même temps que je ne ferai pas face à des confusions lexicales, que je lis le récit d’une personne lucide sur la question de la civilisation et la fin de la chrétienté. Elle dit plus tard : « le christianisme qui est de l’espèce immortelle comme toute religion (il suffit d’une poignée de croyants pour qu’elle perdure), a créé avec la Chrétienté une civilisation, chose éphémère, soumise au temps et aux modes, et éminemment fragile – mortelle » (p.28).
Il y a quelques années, une église évangélique m’avait demandé de prêcher lors d’un culte dominical. Le titre de ma prédication était « la foi, l’expression de foi et l’institution religieuse : pour une distinction salvatrice. » Je pensais honnêtement enfoncer des portes ouvertes. Mais j’ai été étonné de voir que dissocier l’idée de foi d’avec son expression et l’Église fut un choc pour beaucoup. Je me rappelle qu’à l’époque les pasteurs évangéliques que j’ai rencontrés m’enseignaient que vivre sa foi hors église n’était pas envisageable. De la même manière, le christianisme (religion) et la Chrétienté au sens de civilisation étaient totalement amalgamés, ce qui amenait (et amène toujours) des personnes à défendre un héritage chrétien, tout en pensant défendre leur Église et leur foi, sans réellement différencier les notions.
La seconde force du livre réside dans le fait que sans pour autant nier son appartenance ecclésiale et idéologique, elle se permet de poser un regard froid et critique sur les propos tenus par « les siens » : « Je devine que les miens (c’est-à-dire les catholiques traditionalistes), auront tendance à me reprocher ici une forme de relativisme. On ne peut penser qu’en prenant de la distance. » (p.84) Une conviction teintée d’un recul certain puisqu’elle ajoute : « Ce qui fonde une civilisation, ce n’est pas la vérité – car toutes y prétendent -, c’est la croyance en une vérité. Et seule cette croyance garantit la durée dans le temps des choix originaires. » (p. 84) Et d’ajouter plus loin : « Nous avions profané l’idée de vérité, à force de vouloir à tout prix identifier la foi à un savoir. » (p. 125) Dissociant ainsi les notions de croyances, de savoir, de vérité et de foi souvent amalgamées par les croyants, par « les siens ». Elle déconstruit aussi certaines dialectiques du milieu chrétien comme l’argument de l’origine de la morale, par exemple : « Croire ou faire croire que si le christianisme s’effondre, tout s’effondre avec lui : c’est une ânerie. […] Derrière la chrétienté effondrée ne vient pas le règne du crime, le nihilisme, le matérialisme extrême : mais plutôt des morales stoïciennes, le paganisme, des spiritualités de type asiatique. » (p.90)
Le propos de l’autrice
La construction du propos est simple (mais pas simpliste) et très fluide. L’autrice pose une lecture intéressante sur la fin de la chrétienté avant de parler de sa vision de l’Église (catholique) dans une ère post-chrétienne. Elle explique comment pendant 200 ans et depuis la Révolution française, la chrétienté (et non le christianisme donc) est entré en déclin progressif. Et, comment, depuis ce temps, beaucoup se sont battus en vain contre ce déclin. Vient dans les années soixante ce que l’autrice appelle l’inversion normative : une sorte de révolution morale. Elle décrit l’inversion morale qui a eu lieu notamment en lien avec la libération des corps, la facilitation du divorce : autant de notions sur lesquelles l’Église a été (et est encore parfois) très stricte pendant des siècles. Il y a révolution car elle montre comment la même inversion morale a eu lieu au 4ᵉ siècle alors que l’Église prend une place dominante dans la société. L’inversion normative contemporaine étant une sorte de retour à l’origine, une reprise des valeurs païennes d’avant l’installation de l’Église dominante comme matrice civilisationnelle. Une révolution, donc à comprendre dans son sens premier : un tour sur soi-même pour revenir à son point de départ. « L’inversion normative que nous voyons à l’œuvre ici, à travers cette évolution tranquille et décisive qui franchit le 19ᵉ et le 20ᵉ siècle, représente presque exactement le contraire de ce qui se passa au 4ᵉ siècle. Et pour ainsi dire l’inversion de l’inversion. » (p.65) A la différence près qu’au 4ᵉ siècle, les croyances païennes étaient remplacées non par une désaffection ou par négligence de ces adeptes, mais par la force et la vigueur du christianisme. Alors qu’aujourd’hui, la Chrétienté s’affaisse sur elle-même. Ce n’est pas dû à la force d’un mouvement extérieur à elle, mais à sa propre dégénérescence.
Celle-ci n’est pas due au fait que l’incroyance se développe. Mais plutôt au rejet de la modernité opéré par l’Église tout au long de son histoire, et spécialement depuis le Siècle des lumières. L’Église, où pendant de siècles le fidèle était un objet, se heurte en modernité à la liberté de conscience et la liberté de religion. « La Chrétienté comme civilisation est le fruit du catholicisme, religion holiste, défendant une société organique, récusant l’individualisme et la liberté individuelle. Il était naturel qu’elle se heurtât à la modernité, et une fois celle-ci au zénith, son destin était de disparaître. » (p.14) L’incroyance n’est donc pas la raison du déclin de l’église, mais la conséquence du rejet de la modernité, et par extension de son déclin.
Comme le dit l’autrice, la fin de la chrétienté ne signifie pas la fin de la morale. En revanche, on observe que celle-ci a changé d’émetteur. Si auparavant celle-ci était édictée par l’Église dominante et dominatrice, elle est aujourd’hui entre les mains de l’État. « On se souvient que dans les sociétés païennes, la religion et la morale sont séparées : la religion réclame des sacrifices et des rites, tandis que les gouvernants imposent une morale. C’est bien la situation que nous sommes en train de retrouver : notre élite gouvernante décrète la morale, promeut les lois pour la faire appliquer par injures et ostracisme. Notre morale est post-évangélique (note : relative aux évangiles, et non à la religion évangélique), mais elle n’est plus rattachée à une religion. Elle domine les plateaux de télévision. Elle habite toute la cinématographie de ce temps. » (p.139).
Christianisme sans chrétienté
Chantal Delsol termine son ouvrage par un chapitre s’intitulant « Christianisme sans Chrétienté », et ouvrant la question de la place de la religion chrétienne (ici catholique et en France) dans une ère post-chrétienne. Pendant 140 pages, elle s’est donc « contentée » (dis dans un sens positif) de décrire, certes avec son point de vue traditionaliste, mais sans jugement, le monde dans lequel nous vivons en lien avec l’évolution et la fin de la Chrétienté. Ce n’est qu’à partir de la page 145, et pendant une vingtaine de pages, qu’elle va proposer son regard sur la place de l’Église dans la société.
Tout d’abord, elle nous explique que le personnel de l’Église a été atteint par ce qu’elle appelle « la maladie de l’époque », à savoir la mauvaise conscience, la honte et la culpabilité du passé. « [L]e présent, qui se croit habilité à juger le passé dans son entier, se sent parfait. » (p. 146) Assumer le passer, en tirer des leçons pour aujourd’hui et ne pas commettre les mêmes erreurs, oui. Continuer à s’excuser pour des choses qui n’ont plus cours aujourd’hui, faire porter la faute des parents sur leurs enfants, non. Et, pris dans cette culpabilité et cette honte, il se passe ce qui se produit toujours : le « perdant » fait tout pour ressembler au « vainqueur ». Celui qui devient minoritaire embrasse progressivement les positions du majoritaire. Une sorte de compromission de ce que l’on est et de ce que l’on croit. « C’est l’attitude du puissant qui, ayant perdu son hégémonisme et avec elle son aura, vise à en conserver une parcelle en ressemblant à ceux qui sont en train de la lui enlever. » (p.149)
Cela me rappelle une discussion que j’avais avec un ami, pasteur protestant aujourd’hui retraité, qui me disait que « l’Église a perdu sa piété ». En ce sens qu’à force de vouloir ressembler à tout ce qui se fait et qui fonctionne, pour garder un semblant de crédibilité, elle s’est rendue non crédible à une grande partie de ses paroissiens, en plus d’à ceux qu’ils l’ont déjà quitté. Ce faisant, elle a sombré dans une sorte d’entre-soi tiède, n’étant plus vraiment au service du prochain, mais à son service à elle. Elle use d’un vocabulaire pieux dont le sens des mots est devenu flou à force d’amalgames lexicaux et de relativisme : chacun ayant sa vérité, chacun met derrière les mots le sens qu’il veut y mettre. Ainsi, dans une assemblée qui entend une phrase comme : « je vous accueille dans la grâce de Dieu ce matin », il y aura probablement autant de compréhension que de personnes présentes. Les croyants n’ont plus le vocabulaire pour penser leur foi, leur pratique en lien avec le vocabulaire théologique et ecclésial, en plus de perdre un sens commun de la religion. L’exemple du baptême est très parlant : chacun met derrière le baptême le sens qu’il veut : symbolique, culturel, professant ou simplement pour réunir la famille. Je crois que j’entends chez Chantal Delsol un propos semblable à celui de mon ami retraité : « l’Église a perdu sa piété ». Dans une ère individualiste, ce qui compte, c’est le sens que l’on met derrière les mots, et non plus le sens commun qu’ils revêtent. C’est une bonne chose pour les individus, mais si l’on se place du point de vue de l’institution et de sa cohésion, c’est autre chose.
Face à cela, l’autrice propose : « Quand on ne peut pas être une puissance, on peut être un exemple, disait Camus. Ce programme héroïque convient particulièrement bien à une institution spirituelle. Acquérir et conserver la puissance est finalement assez facile, puisque toutes les facultés de bravade peuvent être utilisées : il faut asservir, contraindre et mentir. Mais être un exemple, utiliser les vertus silencieuses, ah, c’est une autre histoire… et on ne voit pas qu’une religion soit vouée à autre chose » (p. 157) « Mais allons plus loin. N’y a-t-il pas d’autres héros que ceux de la force ? Des héros de la patience et de l’attention, et de l’humble amour ? De la quotidienneté, de l’indulgence, de l’équanimité ? Des héros parce que précisément ils ne se vantent pas mais portent tout à l’intérieur […] Renoncer à la Chrétienté n’est pas un sacrifice douloureux. L’expérience de nos pères nous apporte une certitude : notre affaire n’est pas de produire des sociétés ou « L’Évangile gouverne les États », mais plutôt, pour reprendre le mot de Saint-Exupéry, de « marcher tout doucement vers une fontaine » » (p.169-170)
L’autrice propose en gros aux croyants d’être dans le monde, sans en être. Elle invite les catholiques à garder leur spécificité cultuelle, leurs convictions, leurs croyances, et d’entrer en dialogue sans jugement de son vis-à-vis, tout en mettant de côté la question de l’hégémonie et de la suprématie. Ce qui me parait au final être une posture assez adéquate, quelles que soient nos croyances et nos convictions. C’est faire œuvre de témoignage plutôt qu’œuvre de défense. Et bien que je ne sois pas catholique, et probablement en désaccord avec l’autrice sur beaucoup de points moraux, sociaux, théologiques, doctrinaires, sur la question de la croyance… je ne peux que partager son invitation et la posture qu’elle propose, d’autant plus qu’elle est transposable à toute croyance, et plus globalement à tout attachement. Elle a ceci de positif, que c’est une posture qui permet un vrai dialogue, riche et intense.
Une lecture intéressant à bien des égards donc, que je recommande pour aller au-delà encore de ce billet qui ne fait que tirer un trait grossier d’un propos riche.
[…] à une vision qui j’estime passive et passéiste. Sa proposition ne me convainc donc pas. Chantal Delsol a le bon sens de proposer « un christianisme sans chrétienté »…, là ou Sonia Mabrouk offre une proposition chrétienne qui me parait bien hors […]
J’aimeJ’aime